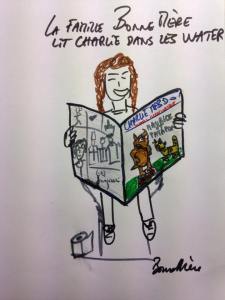Nous nous retrouvâmes au pied du mur. Nous étions sept et le défi de taille : s’immiscer dans une soirée huppée gardée par des gros bras recrutés en nombre. Pourquoi, me demanderez-vous ? Le léger piquant du risque, peut-être, le retour en enfance, sans doute, le goût de la provoc’, sûrement.
D’abord, repérer un lieu stratégique, là où le mur est moins haut, là où le grillage flanche. Puis, se montrer solidaire : l’un fait la courte-échelle à l’autre qui fait la courte-échelle au suivant, et au suivant, au suivant, au suivant, jusqu’au dernier, qui se démmerde.
Là, le jeu commençait vraiment. L’adrénaline monta légèrement lorsque nous gravîmes ce premier obstacle. Retombés de l’autre côté du mur, une forme de joie nous prît aux tripes. Une joie absurde mais réelle. Alors, sans raison et sans un regard, nous nous mîmes à courir. Avec une légère trouille au ventre, mais en riant, nous courûmes comme des fous.
L’étape la plus ambitieuse restait à accomplir : s’infiltrer au cœur de la soirée, de nouveau protégée par des grillages et, surtout, par une vingtaine de bonshommes en noir, peu disposés à rire de nos gamineries. Scotchés tous les sept derrière un arbre trop frêle, nous osions à peine respirer.
Nous dûmes alors repérer un nouveau lieu tout aussi stratégique que le premier. C’était tout vu : les poubelles. Idéales pour la réception de l’autre côté du grillage. Depuis la soirée, certains hôtes entrevirent sept têtes effarouchées dépasser des hautes herbes et atteindre la grille. Re-courte-échelle. Bien trop courte, cette fois, tant il nous fût difficile d’atteindre les poubelles sans conserver quelques douloureuses traces grillagées sur l’arrière des cuisses.
Non sans joie, je fus le premier à me lancer, le premier à empaler mes fesses sur le grillage. Là, je mesurai tout la portée du ridicule. Personne ne me voyait, sans doute – mes amis mis à part -, mais je sentais le regard sarcastique de milliers d’yeux sur mon corps encombrant. Quelques secondes plus tard, je me retrouvai de l’autre côté du grillage, planqué derrière les poubelles. Mon cœur battait avec violence. Je craignais qu’il ne prévienne les vigiles.
Que risquais-je ? Peu de chose, si ce n’est la honte. Cette honte du gosse pris la main dans le sac. Cette honte qui monte aux joues du gamin démasqué lorsque, pris en flagrant-délit, son cerveau bat en retraite, laissant place à un regret cruel.
Soudain, un Eh, toi là bas ! résonna. Ce n’était pas pour moi, mais pour le dernier, celui qui n’avait pas eu droit à la courte-échelle. Il ne bougea pas. Stratégie de la statue, du je-n’existe-pas. Classique. Sauf que dans son cas, la statue était accrochée au grillage, les yeux grands ouverts, l’air ahuri. A la deuxième injonction, il opta pour la solution de repli et fuît, sous le regard d’un gros vigile aux yeux rougis de fureur.
Derrière les poubelles nous étions encore six, pétrifiés. Dans nos petites têtes, c’était fini. Impossible de reculer, mais difficile d’y croire encore. La sécurité alertée, la honte ultime était proche. Alors, dans un mouvement désespéré, nous sortîmes de notre cachette et marchâmes, tout sourire, vers un groupe de garçons costume-cravates, avec lesquels nous jurions sans doute par nos T-shirts trop grands jeans troués baskets délavées. Nous attendîmes patiemment qu’une main rude vienne se poser sur nos maigres épaules afin que nous rendîmes les comptes qu’indéniablement nous devions rendre. A notre grand étonnement, il n’en fut rien.
Après quelques minutes, la frousse laissa place à une petite fierté, accentuée lorsque nous saluâmes, sans doute un brin trop satisfaits, nos amis introduits à la régulière. La mémoire courte, nous nous dîmes que cela n’avait pas été si difficile, finalement.
Cette victoire avait un goût délicat de liberté. Une liberté simple. La liberté de sauter les portillons du métro sans même vérifier la présence de contrôleurs tapis dans l’ombre, ou la liberté, adolescent, de faire le mur pour échapper à des lois tyranniques et arbitraires.
Alors oui, la soirée chic était d’une remarquable fadeur ; mais notre soirée à nous fut un discret triomphe. Parce que oui, ce soir-là, on a sauté le mur.
Papouche